Robespierre, la nostalgie du tyran
- André Touboul

- 30 déc. 2018
- 6 min de lecture
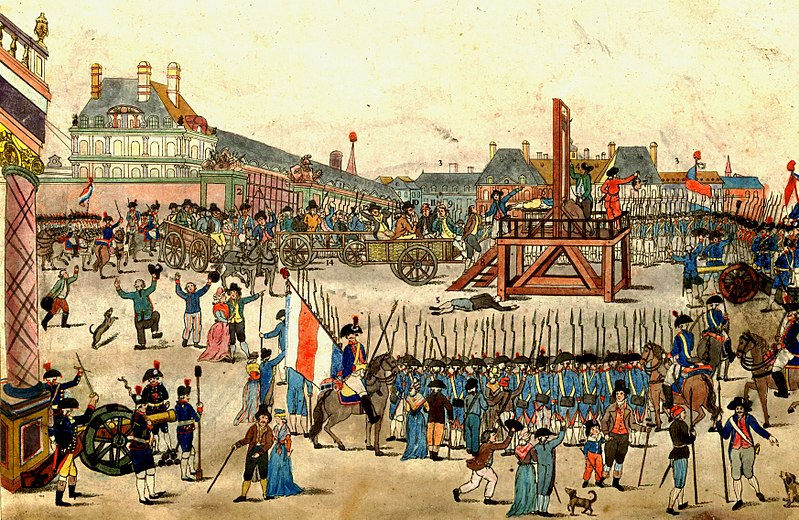
Hallucinant. Dimanche 16 décembre 2018, sur France Culture, une émission consacrée au livre que Marcel Gaucher vient de publier sur Robespierre.
Après avoir entendu chanter les louanges de cet « incorruptible » qui «incarnait le peuple » (diable !) et avait « inventé avant Hegel que l’Histoire avait un sens » (rediable !), il fut professé que Danton était corrompu, car il avait des dettes, mais que Robespierre était intègre puisqu’il n’en avait pas. Jusque là, la routine, bien que sur France Culture on soit accoutumé à plus d’intelligence sinon d’objectivité.
Mais on apprenait soudain que le sommet de la hauteur morale et de l’abnégation fut atteint par Maximilien Robespierre quand il fit guillotiner ses propres amis, Danton et Camille Desmoulins, geste magnifique de sacrifice de sa part.
Étant exclu que les participants à cette émission aient fumé la moquette de la maison de la Radio, qui donne plutôt dans le linoléum, il fallait se rendre à l’évidence. Robespierre rend fou.
De fait, Maximilien que l’on voudrait aujourd’hui faire passer pour un touriste participant du bout des lèvres au Comité de Salut Public, en était bien le chef suprême, au demeurant un brin dérangé.
C’est sur un rapport de Robespierre que le 7 mai 1794 la Convention votait la reconnaissance de l’Etre Suprême et de l’immortalité de l’âme.
Peu de politiques pourront se vanter d’avoir fait voter une religion. Cela n’était qu’un épisode dans le mouvement de déchristianisation de l’époque, mais même Hebert qui prônait le culte de la Déesse Raison, n’alla pas aussi loin que Robespierre qui s’en institua le Grand prêtre. Le jour de la célébration, le 8 juin 1794, les participants se rassemblèrent autour du bassin rond à l'extrémité est du jardin des Tuileries. Sur ce bassin, une pyramide représentait un monstre, l'Athéisme entouré de l'Ambition, l'Égoïsme et la fausse Simplicité.
Robespierre, revêtu d’un habit bleu céleste serré d'une écharpe tricolore, tenait un bouquet de fleurs et d'épis à la main. La foule immense, venue communier aussi à ce grand spectacle, fut ordonnancée par le grand peintre Jacques-Louis David. Robespierre, d'un geste auguste mit le feu à cet ensemble qui démasqua une fois brûlé une statue de la Sagesse.
On peut admettre une utilité politique à offrir au peuple, en des temps troublés, une certaine ouverture spirituelle, mais se mettre en scène de la sorte relève plutôt de la perversité d’une personnalité mégalomaniaque. Le culte de l’Etre suprême disparaît avec Robespierre dont on peut dire qu’il sévit au temps des Lumières sans en être inondé.
Il serait exagéré de prêter crédit à ceux qui prétendent que l’étude de son masque mortuaire révèle qu’il fut atteint de sarcoïdose, une maladie que certains assimilent à une psychopathie, et l’on ne sait si Robespierre a pris un plaisir sadique à faire massacrer les Vendéens, car les historiens professionnels s’étripent sur l’étendue précise de sa responsabilité dans ce massacre qui bien que minimisé par les défenseurs de l’inflexible révolutionnaire, est encore aujourd’hui ressenti comme une brûlure au fer rouge dans le cœur de cette région. On ne juge pas chaque participant à un tel crime au trébuchet.
Il n’en reste pas moins évident que la vie humaine n’avait pas de poids pour Robespierre au regard de ses conceptions idéologiques. Dans son discours prononcé à la Convention nationale, le 25 décembre 1793, il déclare : « Le gouvernement révolutionnaire doit au bon citoyen toute la protection nationale ; il ne doit aux Ennemis du Peuple que la mort. Ces notions suffisent pour expliquer l’origine et la nature des lois que nous appelons révolutionnaires […]. Si le gouvernement révolutionnaire doit être plus actif dans sa marche et plus libre dans ses mouvements que le gouvernement ordinaire, en est-il moins juste et moins légitime ? Non ; il est appuyé sur la plus sainte de toutes les lois : le salut du Peuple. »
Il est possible de trouver des écrits où Robespierre se déclare opposé à la peine de mort de sorte que l’on doit se rendre à l’évidence les convictions humanistes de Robespierre étaient à géométrie variable, au gré de ses projets politiques.
Certes on peut trouver trace de prises de position où Robespierre modérait le zèle des Hébertistes que l’on nommait aussi les « exagérés » et des abus en province. Maximilien était un cynique qui plaçait l’efficacité au dessus de tout. Mais sur le plan de l’humanisme, on peut le mettre en concurrence avec Staline ou Hitler, ce qui fait enrager ses thuriféraires.
En s’en tenant aux faits, il faut admettre que Robespierre fut le théoricien de la Terreur comme méthode de gouvernement, et que ce fut bien lui qui fit voter la loi de Prairial dite de grande Terreur. Grand maître dans l’art de jouer des émotions et des sentiments les mauvais, mais aussi les bons il faut porter à son crédit le vote de l’abolition de l’esclavage des Noirs. On ne sait pas si cette preuve de hauteur d’âme n’était pas motivée par le désir de justifier l’emprisonnement de certains colons qui ne lui étaient pas favorables, plus que par compassion humaine.
Les défenseurs de Robespierre trouveront facilement dans ses écrits des motifs de contester son image de sanguinaire. Mais on peut aussi citer sous la plume de Staline de splendides défenses du progrès humain. Ce type de personnage sait manier la rhétorique.
Selon ceux pour qui la fin justifie des moyens, il y aurait de mauvais dictateurs de droite et de bons dictateurs de gauche. Ce divorce entre la Gauche radicale et la morale universelle condamne cette idéologie en ce qu’elle prétend faire le bonheur des hommes par la contrainte, voire la violence et le crime.
Afin de montrer que l’on peut faire dire tout et son contraire aux personnages historiques, on peut extraire de son Adresse aux Fédérés, cette jolie phrase de Robespierre que l’on pourrait qualifier de criante d’actualité : « Une multitude de fonctionnaires que la révolution a créés, égalent ceux que le despotisme avait enfantés en tyrannie et en mépris pour les hommes, et les surpassent en perfidie. Des hommes, qu'on nomme les mandataires du peuple, ne sont occupés que de l'avilir et de l'égorger. »
Le plus important est de rappeler aux historiens que la vérité historique, la leur, qui curieusement évolue avec le temps et les mentalités, n’est rien à côté de l’usage que l’on fait des grandes figures de l’Histoire. Peu importe qui fut Robespierre, au regard de ce qu’il signifie dans l’esprit du peuple de France qui comme les autres se moque de vérité humaine, et se nourrit d’archétypes.
C’est d’ailleurs là où il faut chercher le désir politique de certains de réhabiliter le tyran. Il s’agit de montrer que la défense du peuple ne peut être que le fait d’êtres supérieurs.
Pour l’anecdote, rappelons que Robespierre n’était pas l’ascète que l’on dit. Avec son âme damnée Saint-Just, il prenait sa part des plaisirs mondains.
Dans l’Histoire des salons de Paris, 1838, la duchesse d’Abrantès raconte une lecture chez Robespierre. Elle décrit l’ambiance de l’époque et témoigne de son rire contraint “Parmi les crimes de la Terreur la mort de madame Roland fut peut être le plus infâme. Apres ce nouvel holocauste. Paris ne fut plus qu’une vaste arène où tombaient des têtes dans des lacs de sang… La terreur enchaînait tous les esprits et ceux qui étaient assez heureux pour échapper aux cachots et à la hache ne pouvaient s’occuper du soin puéril de présidera une réunion causante,… une fête encore moins… Hélas! Qui n’avait pas alors à trembler pour un père une sœur un frère?... et cependant il y avait encore des fêtes dans Paris…Oui on y dansait… on avait l’apparence du bonheur,… on ordonnait de rire“.
Elle poursuit en indiquant que Robespierre“ recevait enfin, il donnait à dîner… on causait… et même l’on riait. C’est en un souper chez Robespierre avec Danton, Saint Just et Brissot que fut décidée la mort de madame de Sainte Amaranthe et de madame de Sartines sa fille“. Son crime avait été de susciter la convoitise sexuelle de Robespierre qui lui avait adressé un sonnet au demeurant indigent. Ce sont des monstres que Madame d’Abrantès décrit, leurs rires sont là pour le prouver.
De fait, Robespierre riait peu. Jules Michelet le décrit ainsi : “La décence d'abord, la tenue d'abord. La sienne était moins d'un tribun que d'un moralisateur de la République, d'un censeur impuissant et triste. Il ne riait guère que d'un rire aigu; s'il souriait de la bouche, c'était d'un sourire si triste qu'on le supportait à peine; le cœur en restait serré“. Histoire de la Révolution, Livre IX, CH. IV.
On trouve dans la Revue des deux mondes, 1832, N°6, sous la plume d’Alfred de Vigny, la trace d’un rire de Robespierre, lorsqu’il confirme au père d’André Chénier la condamnation à mort du poète.
Alors Robespierre, une grande âme ?
Commentaires